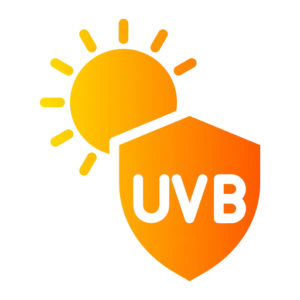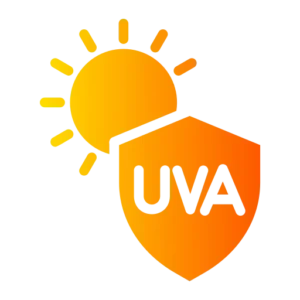L’ hyperpigmentation de la peau induit par les rayons ultraviolets (UV) constitue l’une des principales préoccupations dermatologiques. Cette problématique, communément désignée sous le terme de photovieillissement, résulte d’une exposition chronique aux radiations solaires et se manifeste par des altérations structurelles et fonctionnelles significatives de la peau.
L’exposition aux UV est l’un des principaux facteurs environnementaux du vieillissement de la peau. Bien que l’exposition solaire soit essentielle à la synthèse de vitamine D et contribue au bien-être général, elle constitue également le principal facteur exogène responsable du vieillissement prématuré de la peau. Les rayons UV, invisibles à l’œil humain, exercent des effets délétères cumulatifs sur les structures de la peau, entraînant des modifications morphologiques et fonctionnelles irréversibles.
Le photovieillissement se distingue du vieillissement chronologique par ses caractéristiques cliniques spécifiques et ses mécanismes pathogéniques distincts. Contrairement au vieillissement intrinsèque, qui résulte du passage du temps et de facteurs génétiques, le photovieillissement est directement attribuable à l’exposition aux rayons ultraviolets et présente des manifestations plus précoces et plus sévères.
Hyperpigmentation due au soleil
Mécanismes de production de mélanine

L’exposition aux rayons UV déclenche une cascade de réactions cellulaires complexes :
- Activation des mélanocytes : Les mélanocytes sont des cellules situées dans la couche basale de l’épiderme. Sous l’effet des UV, ils sont activés et commencent à produire davantage de mélanine.
- Libération de médiateurs : L’exposition aux UV entraîne la libération de plusieurs substances chimiques, comme l’α-MSH (hormone stimulant les mélanocytes), l’endothéline-1 et des facteurs de croissance. Ces médiateurs amplifient la production de mélanine.
- Transfert de mélanosomes : La mélanine produite est stockée dans des organites appelés mélanosomes. Ces mélanosomes sont ensuite transférés vers les kératinocytes, les cellules principales de l’épiderme, ce qui donne à la peau sa couleur plus foncée.
- Inflammation cutanée : L’exposition solaire provoque aussi une inflammation locale, qui stimule encore plus la production de mélanine. C’est pourquoi toute agression de la peau (bouton, blessure, irritation) peut laisser une tache foncée, surtout si elle est exposée au soleil.
Types de rayonnements
- Pénètrent l’épiderme
- Responsables des coups de soleil aigus
- Stimulent directement la mélanogenèse
- Pénètrent plus profondément (derme)
- Génèrent des radicaux libres
- Responsables du vieillissement cutané et de l’hyperpigmentation chronique
Signes visibles
Formes d’ hyperpigmentation UV-induite
Mélasma
Le mélasma est une forme d’ hyperpigmentation très fréquente, surtout chez les femmes. Il se manifeste par des plaques brunes, symétriques, localisées sur le front, les joues, la lèvre supérieure et parfois le menton. Il est souvent déclenché ou aggravé par la grossesse (masque de grossesse), la prise de contraceptifs hormonaux ou certains traitements hormonaux. Le mélasma est chronique et récidivant, ce qui le rend difficile à traiter.
Lentigos solaires
Les lentigos solaires, aussi appelés taches de vieillesse, sont des petites taches brunes bien délimitées qui apparaissent sur les zones exposées au soleil, comme le visage, les mains et le décolleté. Leur nombre augmente avec l’âge et l’exposition solaire cumulative. Ils sont bénins mais peuvent être confondus avec des lésions plus graves, d’où l’importance d’un avis dermatologique en cas de doute.
- Macules brunes bien délimitées
- Zones photo-exposées (visage, mains, décolleté)
- Augmentation avec l’âge
Envie d’en savoir plus sur ces deux formes d’hyperpigmentation ? Lisez notre article “Mélasma et lentigo : Différencier les types de taches pigmentaires”
Hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI)
L’HPI survient après une agression de la peau : bouton d’acné, blessure, brûlure, irritation, traitement dermatologique agressif (laser, peeling). Chez les peaux foncées, la réaction pigmentaire est plus intense et persistante. L’exposition au soleil aggrave la situation, car elle stimule la production de mélanine sur la zone déjà fragilisée.
Facteurs de risque
Facteurs intrinsèques
- Phototype : Phototypes III à VI plus à risque
- Prédisposition génétique : Variants génétiques affectant la mélanogenèse
- Âge : Accumulation des dommages UV avec le temps
- Sexe : Prédominance féminine pour le mélasma
Facteurs extrinsèques
- Exposition solaire cumulative : Dose totale d’UV reçue
- Géolocalisation : Proximité de l’équateur, altitude
- Activités professionnelles : Travail en extérieur
- Photosensibilisants : Médicaments, cosmétiques, parfums